Conférence de Marcel Gauchet – Prix Européen de l'Essai
13 mars 2018: la Fondation Charles Veillon remet le Prix Européen de l’Essai à Marcel Gauchet. Captation vidéo de la cérémonie de remise du prix au Lausanne Palace.
Conférence du lauréat.
Réalisation : Daniel Wyss
Texte de la conférence de Marcel Gauchet
Mesdames, Messieurs,
Recevoir ce jour le prix européen de l’essai ne se réduit pas à mes yeux à un simple honneur personnel. J’y vois une invite supplémentaire à la responsabilité envers le sens de l’existence intellectuelle et spirituelle de l’Europe dans un moment où cette existence est de nouveau menacée. Oui, l’esprit européen est une nouvelle fois gravement en péril. « Le plus grand danger de l’Europe est la lassitude », disait Husserl, dans d’une conférence fameuse, en mai 1935, à Vienne. Ses paroles résonnent aujourd’hui avec une actualité étonnante dans un contexte pourtant aussi différent que possible. Ce n’est pas la barbarie stalinienne ou nazie que nous avons à affronter. Au regard des terribles années 1930 au milieu desquelles Husserl essaie de s’orienter et de défendre l’essentiel, nous avons l’insigne privilège de vivre dans les sociétés les plus prospères, les plus pacifiques, les plus libres qui aient jamais existé. Mais cette réussite prodigieuse ne parvient pas à masquer la crise dans laquelle s’enfonce l’esprit européen, une crise dont l’ampleur n’a rien à envier, au final, à la crise totalitaire. Elle a précisément ceci de redoutable qu’elle est douce, silencieuse, insidieuse, lente, sans tragédie. Elle ne procède pas de l’agression frontale d’ennemis déclarés de la liberté et de la raison. Elle découle du déploiement même des principes de la liberté et de la raison. Elle accompagne comme son double caché le triomphe de ce que la culture européenne a produit de meilleur. Comme quoi l’humanité ne connaîtra jamais le repos du « dimanche de la vie ». Les résultats sont là, en effet : l’invention européenne est en panne, la « grande lassitude » qu’évoque Husserl est à l’œuvre, jusqu’à la torpeur, et l’engourdissement peut se révéler à terme aussi mortel que la destruction délibérée.
J’oserai dire que tout mon effort de réflexion depuis maintenant de longues années aura été pour éclaircir le sens de cette invention européenne, tout en dégageant les termes de cette crise qui s’avance masquée.
Les Européens souffrent de ne plus savoir qui ils sont et le paradoxe est que ce qui leur voile ainsi leur identité est l’aboutissement même de l’histoire qui les a faits ce qu’ils sont. Ce n’est autre chose que le parachèvement du processus qui a porté leur dynamisme créateur depuis cinq siècles qui leur en obscurcit aujourd’hui le sens et qui les coupe de leur passé.
Qu’est-ce donc que cette Europe qui a inventé le monde–au sens où elle l’a fait surgir comme un monde unifié–et qui ne sait plus se situer dans le monde ? Qu’est-ce que cette Europe qui a produit une bifurcation dans le cours des sociétés humaines destinée à en bouleverser à jamais, quoi qu’il arrive, la physionomie et le fonctionnement et qui a perdu le fil de cette direction qu’elle a impulsée, au point de ne plus pouvoir lui donner le prolongement qu’elle appelle?
Risquons une définition lapidaire, que sa brièveté n’empêche pas d’embrasser l’essentiel : l’Europe est le continent de la sortie de la religion. La religion entendue non pas dans le sens étroit où la modernité récente l’a confinée, depuis le début du XIXème siècle, comme religion du for intime, de la croyance individuelle et du sentiment religieux. Mais la religion comprise dans la plénitude de ce qu’elle a représenté pour la totalité des sociétés du passé, d’aussi loin qu’on les connaisse, la religion comme clé de voûte de l’établissement humain, comme moule et ciment de l’ordre collectif, comme mode de définition et de structuration de l’être-ensemble. Il faut avoir mesuré l’ampleur et l’épaisseur de cette formidable contrainte venue du fond des âges, contre notre ethnocentrisme de modernes, pour apprécier en regard la portée du miracle européen. Car il est justifié de parler d’un miracle européen, au même titre que du miracle grec, en lui souhaitant de ne pas connaître le même destin.
Le miracle européen a consisté à briser ce cercle en lequel, sous mille et un visages, la condition humaine paraissait inexorablement enfermée. Le cercle des dominations, des hiérarchies, des dépendances et des obéissances, sous le signe de la dette inextinguible envers les dieux, cercle en lequel l’humanité semblait devoir tourner à tout jamais. Nos admirables ancêtres Athéniens n’avaient fait qu’ébranler ce cercle, un court instant, en laissant il est vrai des germes décisifs pour les héritiers que nous sommes. Les Européens ont rompu ce cercle pour de bon et jusqu’au bout.
Ils ont inventé et déployé sur cinq siècles un mode de définition et de structuration des communautés humaines en rupture complète avec le mode de structuration religieux. C’est en cela que consiste proprement et précisément la modernité européenne, devenue occidentale avec sa projection sur le sol américain. Elle est le processus par lequel un mode d’organisation autonome des communautés humaines est sorti lentement et combien conflictuellement de l’immémoriale mode de structuration hétéronome–autonomie et hétéronomie étant à prendre ici dans leurs plus élémentaires acceptions étymologiques : la loi de l’autre, la loi de soi. Ce processus a bouleversé l’ensemble des repères intellectuels, spirituels, culturels, existentiels de l’expérience humaine. Il a fourni la matrice dont sont nés nos sciences et nos arts. La création européenne en son entier est issue de cette substitution. Sous ce que nous appréhendons comme produits de l’esprit, il y a une nouvelle manière d’être des communautés humaines.
Permettez-moi d’évoquer rapidement les traits principaux de cette transformation, afin d’en faire ressortir la portée de rupture. Elle se concentre sous trois chefs essentiels, qui ont nom politique, droit et histoire–c’est-à-dire l’autoconstitution des sociétés humaines, l’autojustification de leur ordre et l’autoproduction de leur cadre. Il y a, bien sûr, un fait politique dans les sociétés religieuses, mais un fait politique impensable comme tel pour les acteurs, puisque l’appareil de commandement n’est qu’une émanation, un relai d’un foyer surnaturel de commandement. Le politique n’apparaît pas pour autant qu’il n’est qu’un prolongement du religieux. Le surgissement du politique au XVIème siècle, pointé par Machiavel le premier et achevant de trouver son concept avec celui d’ « État », signifie, à l’opposé, l’indépendance et la responsabilité du règne humain, désormais en charge de se constituer et de se préserver par ses propres moyens. Ainsi se trouve démentie la loi d’airain des dominations, qui voulait qu’un pouvoir ne soit pouvoir que s’il tombait d’en haut, en répercutant un plus haut que l’homme, par là-même indiscutable. Ainsi va devenir imaginable cette chose extraordinaire, quand on veut bien la regarder avec le recul, qu’est un pouvoir consistant dans la représentation de ceux qui ont à lui obéir.
Il y faudra, pour que cette conception devienne réalité, l’intervention d’un élément supplémentaire qui est le droit. Non pas le droit technique des juristes, qui existe depuis Rome, et qui s’occupe de la légalité, mais un droit nouveau traitant de la légitimité. Une chose qui était là encore inconcevable en temps de religion, où cette source suprême était en Dieu et où c’était à la théologie d’en cerner les raisons. Droit au sens moderne, cela va vouloir dire rapatriement des fondements de ce qui fait droit parmi les hommes au sein du domaine humain, sous l’aspect de ce qui va prendre le nom de « droits de l’homme ». Le légal, désormais, pourra être jugé à l’aune d’un légitime à portée immédiate de la seule raison des acteurs. L’ensemble des rapports entre les acteurs humains devient susceptible d’une autojustification en droit.
Ainsi prend fin ce qui passait pour une autre loi d’airain, la loi d’airain de la hiérarchie, qui voulait qu’il n’y ait de lien solide entre les êtres que soustrait à leur volonté et prenant la forme du lien créé par leur dépendance mutuelle associée à leur inégalité de nature entre inférieurs et supérieurs, dépendance réfractant la dépendance suprême de l’ici-bas envers l’au-delà. À l’inverse, il ne va plus y avoir de lien légitime entre les êtres que bâti sur le consentement entre égaux. De la même manière, il ne va plus y avoir de composition acceptable des corps politiques que construite sur l’accord contractuel des individus également libres qui en sont membres. Principe dont le mécanisme du suffrage qui nous est familier pour désigner nos gouvernants-représentants est la réaffirmation rituelle.
À ces deux éléments spécifiquement modernes, le politique et le droit, va s’en ajouter un troisième, et pas le moins bouleversant, l’élément historique. Qui dit société de religion, société hétéronome, dit aussi société de tradition dans la rigueur du terme : soumission aux modèles du passé fondateur. Car la loi qui vient d’ailleurs et du dessus vient aussi forcément d’avant–d’avant le temps proprement humain. L’extériorité surnaturelle va de pair avec l’antériorité temporelle des origines ou de la fondation. À cette orientation foncièrement passéiste, l’organisation autonome va substituer une orientation futuriste. L’invention de l’avenir va prendre la place de l’obéissance au passé. Ce grand basculement des temps commence au milieu du XVIIIème siècle avec la percée de la notion de progrès, autrement dit la découverte de la capacité pratique d’améliorer la condition humaine et l’organisation de la société. Découverte dont l’approfondissement va conduire à la découverte de l’histoire dans la plénitude de son concept, c’est-à-dire l’autoproduction de leur monde par les hommes, puissance à laquelle le « Prométhée déchaîné » de la révolution industrielle va apporter sa traduction concrète.
C’est en fonction de cette réorientation pratique vers l’avenir que la science théorique du passé, la science historique, je le souligne au passage, a pris la physionomie et la dignité que nous lui connaissons. Elle existait bien auparavant. Le monde humain est par nature un monde successif, en proie aux événements, aux altérations, au renouvellement des personnes et des générations, et il y avait des savants pour enregistrer ces vicissitudes et relater ces péripéties. Mais ce savoir relevait d’une curiosité sans véritable portée, ne touchant qu’à la surface des choses, par rapport à l’ordre profond de la tradition nous reliant au temps d’avant le temps humain, le temps de la fondation. Il n’en va plus de même quand se voit identifiée cette capacité humaine d’engendrer le changement en conscience au lieu de seulement le subir, d’inventer le cadre de son existence, de produire son propre monde. C’est alors que la science du passé devient la science de l’homme par excellence, la science de l’humanité créatrice au passé, corrélative de la création en cours en direction du futur.
L’histoire de la modernité est l’histoire du dégagement progressif et de l’entrecroisement laborieux de ces trois éléments constitutifs, avec le déploiement de leurs conséquences. Ce que nous appelons « démocratie » consiste en profondeur dans le processus politique qui met en forme l’articulation de ces trois dimensions. Tâche problématique, dont on comprend mieux à la lumière de ce foyer les aléas et les difficultés.
Telle aura été la création européenne : l’invention d’un type de société sans équivalent dans l’histoire, sur la base et en fonction duquel aura pu s’édifier une culture tout aussi originale–une culture de l’universel, n’ayons pas peur du mot. Vous m’entendez bien : je ne dis pas une culture universelle, mais une culture qui met l’universel en son cœur, qui gravite autour d’un noyau de règles de pensée et de principes d’action à valeur universelle, de telle sorte qu’ils sont appropriables par d’autres. Ce que le processus dit de « globalisation » ou de « mondialisation » est actuellement en train de vérifier. Il consiste dans l’occidentalisation culturelle du monde. Non pas l’imposition de la culture occidentale au reste du monde. L’appropriation par le reste du monde de ce noyau universel autour duquel tourne la culture occidentale, appropriation destinée à en produire des versions particulières à côté des versions particulières qu’ont pu en donner les Occidentaux.
Or au moment où, de la sorte, ce noyau universel tend à devenir un bien commun à l’échelle du globe, voici que les Européens décrochent, comme s’ils renonçaient à en poursuivre le développement, comme s’ils ne se sentaient plus à la hauteur de leur propre invention. Ils sont en cela victimes de l’illusion sécrétée par l’aboutissement même de leur invention.
Car ce qu’il nous a été donné de vivre depuis une quarantaine d’années, la datation étant relativement précise, c’est le parachèvement de ce parcours. La transformation a été suffisamment ressentie pour que d’aucuns croient discerner dans la nouvelle époque ainsi en train de s’ouvrir une « postmodernité », un au-delà de la modernité classique. La vérité est que c’en est l’accomplissement radical. Mais un accomplissement, qui, loin de dépasser les problèmes qui tourmentaient nos prédécesseurs, nous jette devant un problème plus grand encore, le problème que j’évoquais en entrée et qui menace l’existence de l’Europe au moins dans son identité inventive – si ce n’est pire.
Jusqu’à une date récente, en dépit de l’ampleur de ces ruptures avec l’ancien ordre religieux, les sociétés européennes modernes demeuraient en continuité avec les sociétés du passé, fût-ce pour les prendre comme repoussoirs. Ce lien avec ce dont elles s’éloignaient leur donnait une forte conscience à la fois de leur originalité et de leur particularité. Les règles de la représentation se combinaient avec une autorité des pouvoirs rappelant, même de très loin les anciennes dominations. L’individualisation par le droit s’associait à de solides appartenances collectives. L’orientation futuriste s’inscrivait à l’intérieur d’un enracinement assumé dans le devenir antérieur. En fait, ces diverses attaches relevaient d’une empreinte continuée de la structuration religieuse. Celle-ci ne commandait plus, mais elle maintenait officieusement une présence effectuante derrière les rouages officiels.
Ce qui s’est produit, très spécialement en Europe, au cours des trois ou quatre dernières décennies, à une vitesse stupéfiante, compte-tenu de la profondeur de temps engagée dans ces permanences, c’est l’effacement de cette empreinte de l’univers hétéronome et la dissolution des attaches qui continuaient malgré tout à nous relier à lui. C’est ce qui confère un caractère absolument inédit à la situation actuelle. Il en est résulté une métamorphose de ces éléments structurants qui nous les rend spontanément méconnaissables par rapport à leurs expressions antérieures. Tant le politique que le droit et l’histoire ont changé de visage, jusqu’à faire croire, pour certains d’entre eux en tout cas, le politique et l’histoire, à leur disparition. En réalité, l’analyse montre qu’ils n’ont fait qu’aller au bout de leur redéfinition moderne, mais au prix de changement spectaculaire d’allure et de place.
Dans l’opération, sur le vu de ces apparences, l’invention européenne de l’autonomie a changé de signification aux yeux de ses acteurs, et changé d’une manière qui les trompe. Elle en est venue à se comprendre de part en part sous le signe de cette catégorie dont j’ai trop rapidement souligné la centralité tout à l’heure : la catégorie de l’universel. Le nom du produit le plus remarquable de ce parcours et le nom, désormais, de la difficulté à le poursuivre.
Les Européens entendent vivre selon l’universel, et les conditions à la fois civilisationnelles et institutionnelles qui prévalent sur le continent les entretiennent dans cette conviction et dans cette volonté. C’est l’énorme différence qui les sépare des États-Unis, projection des mêmes données de base de la modernité de l’autre côté de l’Atlantique, mais où les mêmes références à l’universel restent ancrées dans le destin spécifique d’une terre d’élection.
Les Européens, eux, ne veulent plus connaître de particularité, à commencer par la leur. Ils aspirent à se gouverner selon l’universalité du droit et des droits fondamentaux des individus. Ils entendent agir selon l’universel des règles que la raison fournit à l’action, qu’il s’agisse de la connaissance scientifique et des concrétisations de ses résultats sous forme de moyens techniques ou encore des principes du calcul économique. De ce fait, ils ne se connaissent plus d’histoire–ils sont passés dans une sorte de post-histoire pour laquelle n’existe plus que le présent perpétuel de l’abstraction rationnelle. Ils sont indifférents à une géographie qui les enfermerait dans une particularité territoriale inutilement limitante.
Ambition admirable, en un sens, à ceci près qu’elle est irréelle et qui plus est destructrice. Elle oublie ce qui a permis à cet avènement de l’universel de se frayer un chemin. L’universel n’existe nulle part de manière immédiate. Il est sous tous ses aspects un produit au second degré, élaboré à partir d’une matrice particulière dont il ne peut entièrement se détacher, qu’il s’agisse des rapports entre les êtres, de la démarche de connaissance ou de l’action sur la nature, même si cette universalité seconde a vocation à informer en retour les matrices particulières dont elle est issue–mais seulement jusqu’à un certain point. Le grand art, le chef-d’œuvre de l’intelligence humaine réside précisément dans l’équilibre à trouver entre ces deux faisceaux d’exigences, celles qui tiennent à la donation première et celles qui découlent de la construction dérivée.
Il y a pire encore, la poursuite de cette universalité alimente une dynamique de l’artificialisation du monde humain-social qui le coupe de son environnement naturel et menace son élémentaire survie biologique.
Tel est le foyer intime de la désorientation et du désarroi qui troublent aujourd’hui l’humanité européenne dans tous les ordres, politique, bien sûr, le plus manifeste, mais aussi bien social, intellectuel, spirituel, culturel, existentiel. Loin de nous mener à une fin de l’histoire paisible et sûre d’elle-même, le parachèvement de cette organisation autonome si péniblement conquise durant tant de siècles nous jette devant le problème le plus difficile que l’humanité ait jamais eu à résoudre, en pratique comme en théorie. Il réclame d’éclaircir et d’assumer en connaissance de cause les conditions de possibilité et de praticabilité de cette universalité que ç’a été le miracle européen d’amener au jour et qui est l’autre nom de la liberté dans la plénitude de son acception : l’autonomie, le pouvoir de se gouverner dans toutes ses dimensions. Une tâche que l’engourdissement actuel de l’esprit européen ne lui laisse même pas envisager.
Nous aurions, j’aurais, en tout cas, l’âme davantage en paix si nous étions assurés qu’il ne s’agit que d’une translatio impérii comme il y en a eu d’autres, où, tandis que nous succombons à la « grande lassitude » qu’évoquait Husserl, d’autres se préparent à prendre la relève et à porter le flambeau. Outre qu’elle est des plus incertaines, cette perspective me semble moralement inacceptable. Je ne m’y résigne pas. Je veux croire au réveil de l’invention européenne face à ce nouveau seuil qui se présente à franchir. J’entends en tout cas y consacrer ce qui me reste de temps et de force. Je ne puis que vous être profondément reconnaissant de m’y encourager.
Marcel Gauchet (13/03/2018)
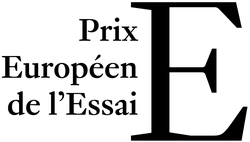
 retour
retour